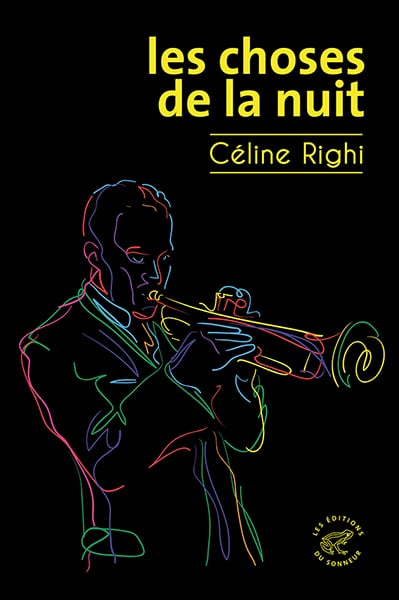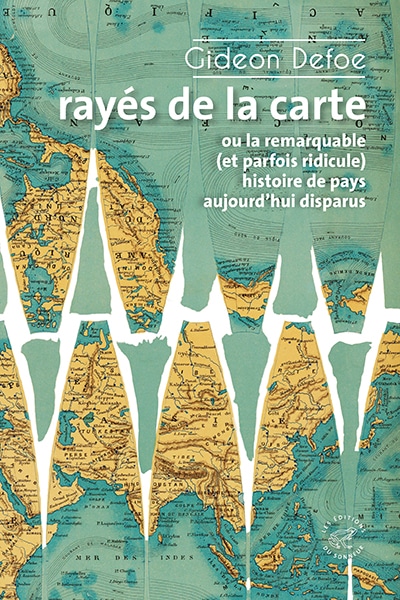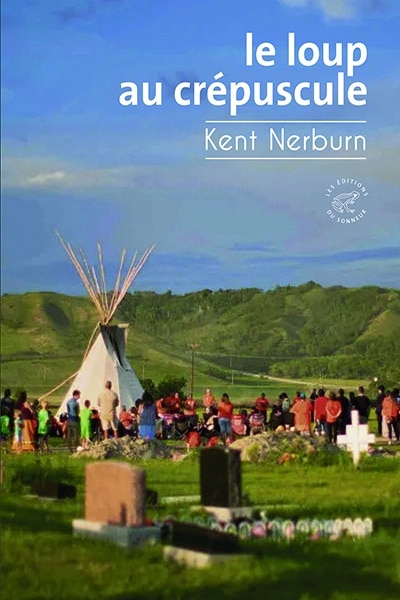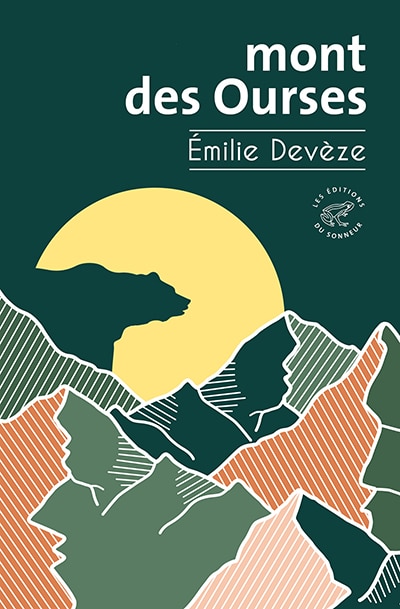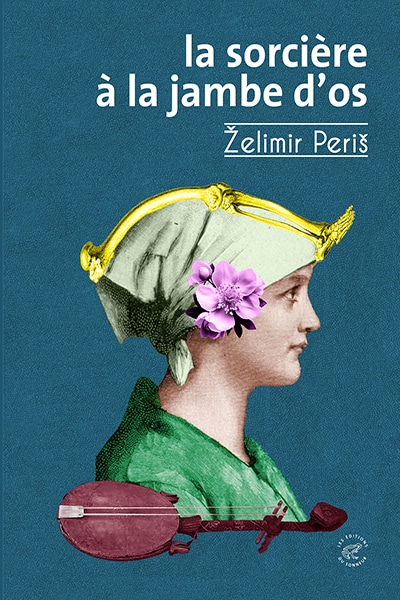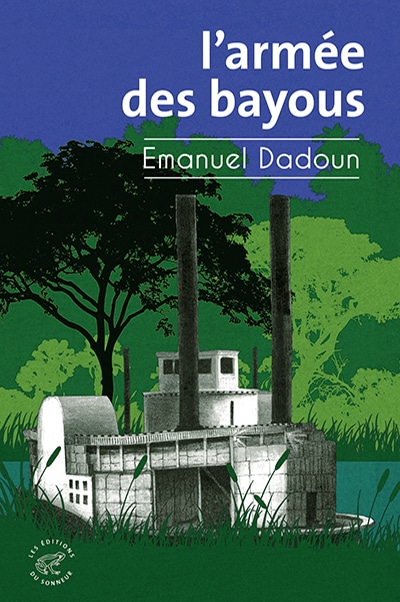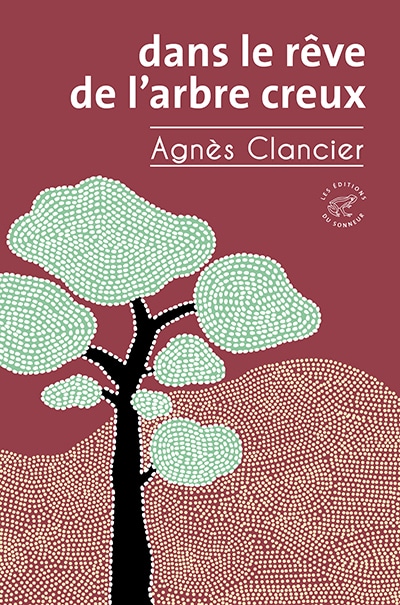Après Gerda
Pierre-François Moreau
À la fin du mois d’août 1937, le reporter de guerre Robert Capa débarque à New York après une traversée de l’Atlantique en paquebot. Il a 23 ans, il est déjà veuf : un mois plus tôt, sa compagne photographe Gerda Taro a été tuée lors de la guerre d’Espagne à Brunete, près de Madrid, alors qu’il se trouvait à Paris.
Ce séjour est l’occasion pour Capa de s’extraire de son désespoir et de mener à bien un projet de livre. Un album à la mémoire de Gerda, intitulé Death in the Making, pour évoquer en images les douze derniers mois qu’ils ont passés en Espagne à couvrir la Guerre civile.
Après Gerda, livre sur la naissance d’un livre, roman où se mêle histoire et fiction, recrée le tourbillon de ces six semaines à New York, lors desquelles remontent les souvenirs de cette année 1936-1937, ses violences, ses déchirements qui bouleversèrent aussi bien le couple Taro-Capa que l’Europe entière.
Né en 1954, Pierre-François Moreau est romancier et scénariste.
Entretien Frédéric Lemaître • Persona n°7
L’AMOUR À MORT
Pierre-François Moreau, d’abord nouvelliste, a fondé Acte Gratuit au début des années 80, un gratuit littéraire parisien dans l’esprit d’alors. Il en évoque les circonstances dans Suicide, œuvre majeure, qu’il a écrit pour Persona. À cette même période, il collabore à Libération et Actuel, puis au cours des années 90 à plusieurs magazines et hebdos, comme Reporter ou Chroniqueur. Depuis les années 2000, entre nouvelles et romans (Vertige de l’inaction, Les mal passés, La Soif), il est script-doctor de documentaires, notamment musicaux, et scénariste de longs-métrages. Son dernier roman Après Gerda, qui nous a fait flasher, révèle les ambiguïtés amoureuses et photographiques du couple Robert Capa et Gerda Taro durant la guerre d’Espagne.
Avec ton livre, les lecteurs découvrent qui était Gerda Taro, mais au départ il ne s’agissait pas d’un roman.
Oui, d’une commande de deux producteurs français, un biopic sur Gerda Taro. J’ai travaillé environ un an sur le scénario, mais le projet a été abandonné pour des questions de montage financier. J’étais déçu, d’où l’envie d’écrire un roman. Une entreprise plus modeste…
Justement, par quel biais as-tu travaillé la trajectoire de la fiction ?
Je voulais m’écarter du scénario. Et j’ai décidé de prendre, non pas Gerda Taro, mais Robert Capa comme personnage principal. C’est lui qui allait la raconter. À l’objectivité biographique, j’ai choisi la subjectivité littéraire. Entrer dans la tête de Capa, m’a mené à écrire le roman à la première personne et faire le récit de son voyage à New York à l’automne 1937 s’est imposé. C’est juste un mois après la mort de Gerda. Capa est abasourdi. Il débarque avec l’idée d’un livre en son hommage, avec leur dizaine de reportages réalisés en Espagne les douze mois précédents. Death in the making est un livre un peu mythique, publié en février 1938, qui n’a jamais été réédité.
New York crée une suspension. Un moment de paix. L’effet de réminiscence que Capa a forcément eu en rassemblant les images du livre, me permettait de limiter les séquences en Espagne. De mettre la guerre à distance.
Quels sont les éléments réels à New York sur lesquelles tu as pu t’appuyer ?
Il y a peu d’éléments sur ce séjour, de six semaines environ. Dans les différentes biographies, il court sur quelques lignes, ou une page à peine, ça me laissait une marge romanesque pour imaginer comment ça avait pu se passer.
Capa y arrive en compagnie de Ted Allan, un jeune Canadien commissaire politique, présent lors de l’accident qui a coûté la vie à Gerda. Ted s’en est tiré avec une jambe cassée. J’ai retrouvé ses carnets où il raconte les circonstances. Les deux hommes s’installent à l’hôtel Bedford, à Manhattan. Un repère de journalistes étrangers. En plus d’André Kertész qui fera la maquette, et de Léon Daniel, qui va devenir son agent aux États-Unis, Capa contacte l’éditeur Covici qui publie John Steinbeck, et va éditer le livre. Il revoit Jay Allen, un journaliste du Chicago Tribune qu’il a connu à Bilbao, à qui il confie la préface. Il rencontre aussi Edward Thompson de Life magazine où Capa essaie de se faire engager. Il retrouve également son frère Cornell et sa mère, qui ont quitté Budapest… Ça compose déjà une galerie de personnages, des situations.
Et sur l’année que le couple passe en Espagne à couvrir la guerre ?
Mes sources principales sont Richard Whelan, le premier biographe de Capa, et Irme Schaber, une universitaire allemande qui, dans les années 1990, a fait une thèse sur Gerda et a écrit sa biographie. C’est Schaber qui a dissocié les photos de Gerda de celles de Capa, du fonds géré par l’agence Magnum qui après la mort de Capa en 1954 les a toutes attribuées à Capa. Gerda Taro n’a travaillé comme photographe que quelques mois. Quand Lucien Vogel de l’hebdomadaire Vu lui propose de partir en Espagne, Capa n’a aucune expérience. Il convainc Vogel que Gerda l’accompagne, de l’intérêt d’un « regard de femme ». Gerda que Capa appelait « le Chef» a dû insister… Ils sont alors en couple depuis un an. Capa l’avait fait engager à l’agence photo de Maria Eisner, elle proposait des photos aux journaux, rédigeait des légendes. Sans lui, elle ne serait jamais devenue photographe. Au début, elle double surtout les scènes avec un Rolleiflex. Après leur retour de ce premier reportage, à l’automne 1936, Gerda ne trouve pas d’engagement, on la juge peu professionnelle. Elle part en Italie retrouver son ancien fiancé allemand, qui ne veut pas renouer avec elle, mais s’engager comme médecin brigadiste. Elle rentre à Paris. Ensuite, Capa n’a de cesse de tenter de reformer leur couple. En mars 1937, il la fait engager par Louis Aragon au quotidien Ce soir. Elle repart alors seule et signe ses premiers reportages. Elle lui vole même la vedette à Guadalajara, l’une des premières victoires républicaines. Pas rancunier, Capa l’embarque à Ségovie en mai 1937, la bataille que décrit Hemingway dans Pour qui sonne le glas, où elle présente Capa aux officiers présents comme « son mari », alors qu’ils sont toujours séparés… Leurs parutions dans la presse m’ont servi de repères dans leurs relations.
Tu disais avoir été déçu lorsque tu as ouvert Death in the making, le livre de Robert Capa, pour la première fois, mais par quoi ?
Par la préface de Jay Allen, qui raconte un peu n’importe quoi sur le couple. Il prétend qu’ils sont mariés et il se trompe sur plein de détails, que les deux se seraient connus en Allemagne par exemple, alors que c’est à Paris… Allen brode ! À mon avis, Capa l’a enfumé, il ne voulait pas avouer qu’il était pendant un temps le compagnon délaissé, trompé. Il s’arrange avec les inconstances de l’amour…
Mais tu y as quand même découvert des éléments significatifs ?
Oui, j’ai perçu dans la sélection de Death in the making comme un sous-texte. La première photo, ce sont des adieux à la gare de Barcelone, un volontaire embrasse une petite blonde. Capa appelait ironiquement Gerda, qui mesurait un mètre soixante,« ma petite blonde ». Et la dernière photo du livre a été prise par Gerda à Madrid, en présence de Capa lors du Congrès International des Écrivains. On y voit deux soldats républicains arrivant de Brunete présenter des bannières ennemies. Elle va y mourir trois semaines plus tard. Ça esquissait un effet de narration. Ça m’a intrigué.
Il y a aussi dans le livre une photo qui n’est ni de Gerda ni de Capa, mais de Chim, leur copain. Chim n’est d’ailleurs pas crédité. En soi, la photo n’a pas grand intérêt : on y voit deux soldats qui mettent à l’abri un tableau au musée du Prado à Madrid. Mais, à cette période, c’est grâce à Chim qu’entre eux le sentiment va se renouer. J’ai alors pensé qu’il y avait dans ces photos de guerre, ce que j’ai appelé un hors-champ sentimental. C’est sur ça que j’ai travaillé. J’y ai cherché une double lecture. J’ai aussi constaté qu’il manquait des reportages, réalisés aux moments les plus tendus de leurs rapports, sentimentaux ou professionnels. C’est subjectif, mais ça m’a aidé à distinguer plus nettement le mouvement de leur relation sentimentale, que les biographes esquissaient, faute d’informations, ont-ils écrit. Et c’est ce qui donne, je crois, de l’épaisseur au roman.
La photo de couverture de Death in the making est peut-être la plus connue de Capa, c’est aussi celle de la polémique.
Cette photo ne va pas bâtir sa réputation, comme on le dit. C’est même le contraire. Lucien Vogel, le rédacteur en chef de Vu, a dû démissionner sous la pression de la direction suisse, parce qu’après la parution, des lecteurs ont protesté de sa violence et se sont désabonnés. Capa a arrêté sa collaboration. Si elle reste célèbre, c’est parce qu’elle est forte, et qu’elle est ressortie dans les années 60 et 70, en France, en Espagne et ailleurs. Des organisations anarchistes l’ont utilisée en affiche pour illustrer leur lutte antifranquiste.
Cette photo que tu nommes Le milicien tombant est nommée en général Mort d’un soldat républicain.
L’homme n’est pas un soldat républicain, mais un milicien anarchiste, membre du syndicat paysan andalou qui a pris les armes. Il n’a pas d’uniforme et porte des espadrilles. Les paysans réclamaient une réforme agraire, une répartition des terres, ce que le gouvernement socialiste va leur accorder. C’est en partie pour cette raison que Franco et les putschistes, soutenus par les propriétaires terriens, se soulèvent. En septembre 1936, date de la photo, l’armée républicaine n’existe plus. Quant au milicien, il n’est pas mort à ce moment-là.
Tu soutiens donc la thèse que cette photo n’a pas été prise sur le vif.
Oui. À mon avis, ce n’est pas Capa qui la met en scène, comme on le dit, mais l’homme qu’on voit sur l’image. Il s’appelle Federico Borrell Garcia. Il a été identifié par le biographe Richard Whelan. Borrell Garcia veut dire au monde, ce monde qu’incarne Capa avec son Leica, qu’il est prêt à mourir pour ce champ. C’est ce que l’image dit. Et il sera tué à Cerro Muriano, les jours suivants, peut-être le lendemain. Capa a du l’apprendre puisque, avec un certain remords je pense, il a écrit sur la bobine du film «Cerro Muriano » quand il l’a envoyé par avion à la rédaction de Vu. Après tout, c’est là que Borrell Garcia était mort. J’ajoute que Capa a 23 ans, ça fait trois semaines qu’il est en Espagne. Il n’a pas d’expérience. Il ne peut pas proposer à un milicien de jouer ce jeu morbide. Ça ne correspond ni à la situation ni à son tempérament.
À voir cette photo, on a pourtant l’impression que Capa est sur le front.
Borrell Garcia et ses camarades sont à l’exercice, précisément à Espejo, près du Qartier Général, à 50 km du front. Par Google Map, c’est aujourd’hui prouvé. Il n’y a jamais eu de combats à Espejo. Capa et Gerda, comme les autres photographes et journalistes, y sont consignés. L’état-major ne voulait pas les voir sur le terrain. Les défaites s’enchaînaient. On se méfiait des espions. D’ailleurs, c’est à ce moment-là que le métier de photographe de guerre est né. Le Leica III, léger, robuste, qui se charge avec des pellicules de cinéma que l’on se procure facilement, le permet.
Le relationnel compliqué du couple est aussi au cœur du livre.
Plus que les événements politiques et militaires, je voulais raconter leur amour. Un sujet majeur en littérature. Un amour rendu d’autant plus instable par la guerre. Une relation de couple et d’associés est souvent complexe. L’un est le miroir de l’autre. Selon moi, Capa utilise autant qu’il peut les événements militaires et les engagements professionnels pour reconquérir, ou re-séduire Gerda. Et il y parvient !
Qu’est-ce qui pouvait motiver deux jeunes gens à s’engager dans cette guerre ?
Participer à l’Histoire. Lui est hongrois, elle, polonaise, mais a toujours vécu en Allemagne. Ils sont juifs. Tous les deux ont fait quelques semaines de prison, elle, à Leipzig, lui, à Budapest. Ce sont des réfugiés, sans beaucoup de possibilités de travail. Les fascistes sont leurs ennemis déclarés, donc…
Tu évoques le moment terrible où, à Paris, Capa apprend la mort de Gerda en lisant le journal L’Humanité.
Oui, il attendait les accréditations du bureau parisien de The March of Time. Ils allaient partir en Chine, tourner un film d’actualités sur la guerre sino-japonaise. C’est cruel, parce que c’était vraiment une promotion. Elle devait rentrer le lendemain ...
Ton livre parle aussi de la difficulté d’une femme à s’imposer comme reporter de guerre.
Elle avait manifestement du talent, de l’intelligence et de l’ambition. Elle était issue d’une famille d’intellectuels, alors que le père de Capa avait une petite boutique de tailleur à Pest. Elle était partagée entre différentes options. Mais plutôt qu’une vie rangée, elle choisit l’émancipation. De devenir photographe, et réalisatrice de films d’actualités. Elle a pensé que Capa était le plus à même pour l’aider à réussir ce pari.
Roger-Yves Roche, En attendant Nadeau
Après Gerda est l’histoire d’un livre que Robert Capa a « offert » à Gerda Taro, sa compagne photographe morte sur le front de la guerre d’Espagne à vingt-sept ans. Il aurait pu tout aussi bien s’appeler « Après l’amour ».
Le livre a fini par exister : Death in the making, photographies de Robert Capa et Gerda Taro, publié à New York en 1938, et que l’on pourrait traduire par « La mort à l’œuvre ». On le trouve parfois en vente sur des sites spécialisés, à un prix prohibitif. On peut aussi le feuilleter en ligne, mais c’est moins bien. La main a trop besoin de caresser le destin, sentir l’Histoire sous l’odeur des pages jaunies, soulever, oublier le voile triste de l’image : « Ce livre sera brutal, tranchant, blanc, gris, noir. Une lutte, telle que nous l’avons saisie. Pas une ode à la première reporter de guerre tombée au front, à la militante communiste à titre posthume. Pas de lamentations. »
C’est l’histoire de ce livre, de sa conception, que raconte Pierre-François Moreau dans ce roman qui aurait pu s’appeler « Après l’amour ». Ou après la guerre. Ou après la mort. C’est que Gerda, la presque compagne de Capa, le « plus grand reporter de guerre de tous les temps », meurt à vingt-sept ans, écrasée par un char républicain près de Madrid. Pas de mise en scène dans cette scène-là, la mort crue, à laquelle on ne peut pas croire. Capa a perdu la moitié de sa vie, il ne s’en remettra jamais : « Moi, je ne suis qu’une ombre qui tremble, qui grelotte. En plein mois d’août, dans la touffeur du jour, je bois pour me réchauffer. Je suis mort, mais je m’obstine. »
Moreau s’installe dans la tête de Capa : la traversée de l’Atlantique, New York, l’été finissant. Il y a plus confortable. Ça tangue, ça remue, les souvenirs tremblent, le film est parfois granuleux. Aimer Gerda a trop souvent signifié tenter de l’aimer, l’approcher, l’apprivoiser presque. De fait, la belle ne s’en laisse pas conter, ou alors c’est pour la photo, clin d’œil contre clin d’œil. Pour la vie ensemble, il faudra repasser. Et vite. Avant qu’un autre ne lui mette le grappin dessus, ou l’Histoire son veto. Elle, la photographe qui ne craint rien ni personne, n’a pas froid aux yeux : « Autorisée à suivre la XIe Brigade internationale absorbée par la 35e division, sous le commandement du général Walter, elle s’était rendue presque tous les jours à Brunete depuis le début juillet. Elle avalait à pied les dix derniers kilomètres vers le front, appareils, trépied et caméra à l’épaule. »
Jusqu’au début des années 2000, Gerda Taro, née Gerta Pohorylle, Juive allemande qui a fui son pays en 1933, était un peu l’inconnue de la photo. On la voyait toujours dans l’ombre de Capa. Et puis Irme Schaber et François Maspero sont passés par là, commençant d’œuvrer pour sa réhabilitation, sa juste remembrance. C’est que Gerda n’a pas seulement « inventé » Capa, « trouvé » son pseudonyme (il s’appelait en réalité Endre Ernő Friedmann, nom trop juif pour l’époque), changé son allure, elle a aussi photographié, aimé, existé… Dans et hors la légende Capa !
Car légende, ou légendes, de Capa il y a. Et Moreau ne se prive pas de rappeler le plus célèbre de ses démêlés avec la vérité, la mort d’un soldat républicain, photo peut-être-peut-être pas mise en scène, peut-être-peut-être pas prise à l’endroit que l’on croyait. On dirait Capa toujours entre deux histoires, deux vies, deux mondes. Un peu comme Taro, donc. Voilà sans doute pourquoi ils se retrouvent à la guerre, comme en photographie : « Sur le terrain, saisir ce que raconte le moment m’occupe l’esprit. Je ne pense à rien d’autre. Je développe une sorte d’emprise et d’invisibilité. »
L’époque de Capa & Taro, c’est l’épopée des magazines et revues qui comptent leurs abonnés par centaines de milliers, la course contre la mort contre 10 malheureux cents, l’image toujours plus près (la formule est vérifiée par Capa lui-même : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près »). Life veut plus que de la vie, Vu du jamais vu, etc. Il n’y a donc pas de repos pour les photographes de guerre, que l’éternel. Ce qui se passa pour les deux susnommés, à moins de vingt ans d’intervalle – 1954, en Indochine, pour Capa.
D’une certaine manière, c’est un tombeau d’amour que Capa offre à Taro. Car à la fin (même si l’on peut se demander quelle fin…), le grand reporter parvient à publier son livre, leur livre. Des photos de la guerre civile en Espagne. Des photos d’elle, des photos de lui. Des visages en gros plan, des scènes de rue, la grisaille des combats, les murs décrépi(t)s, des blessés-vivants, la foule le poing levé comme un seul homme et tant d’autres encore… On ne les voit pas ensemble, on les devine. Hemingway et Kertész ont mis la main à la pâte. Et Moreau-Capa de faire de même avec son livre : « En Espagne, nous sommes face à une histoire qui dépasse le cadre de l’image, du récit. Raconter la guerre d’Espagne, c’est comme raconter l’Amérique. Death in the making montrera des fragments qui ne sont pas seulement des faits, des situations, des idées, une esthétique, mais aussi quelque chose d’objectivement humain. Même si au fond ce qui compte pour moi, c’est son hors-champ sentimental. »
ISBN : 9782373850796
ISBN ebook : 9782373850871
Collection : La Grande Collection
Domaine : Littérature française
Période : XXIe siècle
Pages : 160
Parution : 24 mai 2018