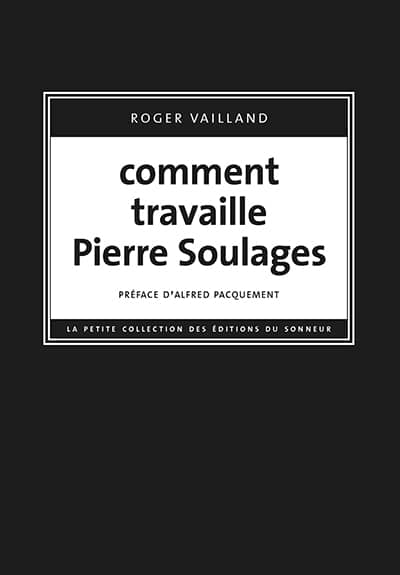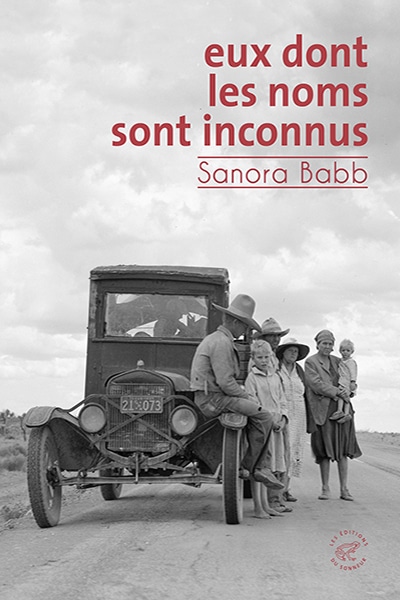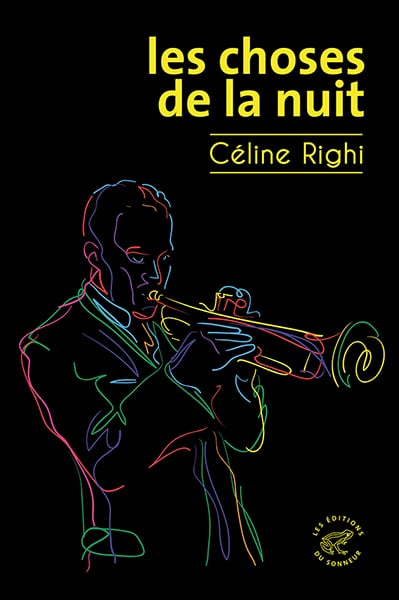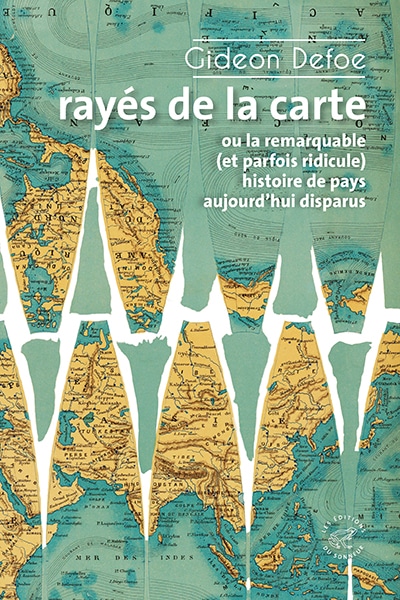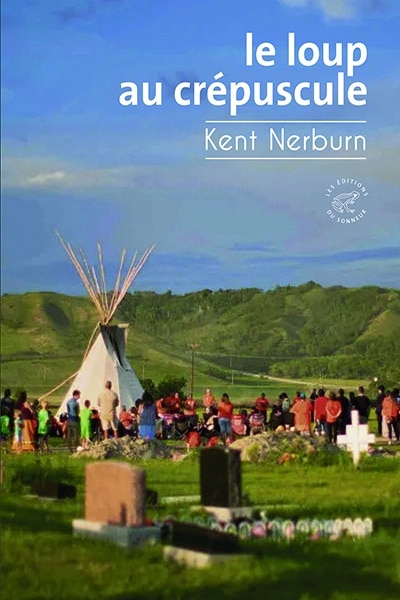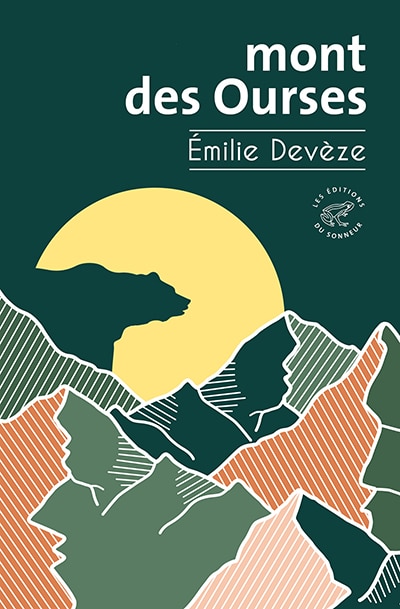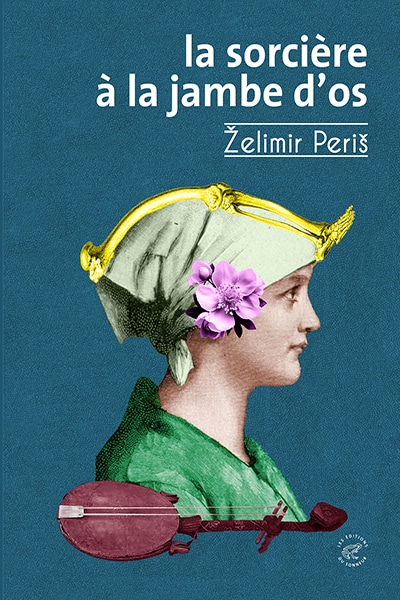Ce que disent les morts et les vivants
Jean-Marie Dallet
Préface d’Alberto Manguel
« Vous, les morts et les vivants, ce n’est plus la peine que je vous rappelle à moi par d’enfantins subterfuges puisque, quoi que je fasse, vous me hantez toujours. »
Comment se construire dans l’ombre d’un grand-père devenu aveugle dans les tranchées de 14-18 et qui, malgré son infirmité, décide de continuer à vivre et de poursuivre son métier d’instituteur ? Comment, quand on veut devenir écrivain, échapper à la figure tutélaire d’un père publié dès son premier manuscrit et rapidement nommé secrétaire littéraire chez Denoël, avant de mourir au combat lors de la débâcle de 1940 ?
Jean-Marie Dallet entremêle cette fresque familiale et celle d’un siècle troublé par une succession de guerres dont chaque génération aura la sienne — Première et Seconde Guerres mondiales pour le grand-père et le père, guerre d’Algérie pour le fils et narrateur, qui, tel un noyé à la recherche d’oxygène, tente de remettre la main sur sa propre vie. Et comme le souligne Alberto Manguel dans sa préface, tout au long de ce roman « le lecteur éprouve le sentiment d’être témoin de cet ancien acte interdit qu’est la création, de se trouver soudain en présence de quelque chose de magiquement vivant, quelque chose qui frémit et rampe sur la page, se métamorphosant de paragraphe en ultime paragraphe, à peine contenu entre les marges du livre ».
Depuis Les Antipodes, édité au Seuil en 1968 et préfacé par Marguerite Duras, Jean-Marie Dallet a écrit une quinzaine de romans publiés par les Éditions Robert Laffont, Lattès ou Plon : Gauguin ou l’Atelier du tropique (1976), Waterman bleu-noir (1978), Je, Gauguin (1981), Dieudonné Soleil, qui obtint la Bourse Goncourt du récit historique en 1983, Fin de partie au Sans-Soucis (1989), Veilleur où en est la vie ? (1994), Au Soleil des vivants (1998), Tentative de fuite (2000)… Ce Toulonnais d’origine bretonne a toujours « navigué » entre la Méditerranée, le Pacifique Sud et Paris.
Marie Masson, Les Lettres françaises
Jean, le narrateur, la soixantaine, est le dernier de la lignée des Lecoeur. Derrière lui, trois générations de martyrs tricolores. L’ancêtre, Louis, est blessé à la guerre de 1870, décoré, nommé facteur rural à La Mothe-Saint-Héray. Il est marié à Marguerite, Poitevine, lavandière. Ils ont un fils, Désiré. Désiré travaille d’arrache-pied pour devenir instituteur, il se marie à Eugénie, elle aussi institutrice. Grièvement blessé le 6 juin 1915 dans la boucherie des tranchées, aveugle de guerre, décoré de la croix de guerre et de la Légion d’honneur, Désiré s’obstine, enseigne malgré son infirmité. L’école de Nantes où il achève sa carrière porta son nom. François, le fils d’Eugénie et Désiré, communiste, écrivain prometteur (son premier et unique roman obtient des voix au prix Goncourt), est tué le 6 juin 1940, à vingt-six ans, à côté de Soissons. Son nom est au Panthéon, gravé sur le marbre commémorant les écrivains morts pour la France pendant la guerre de 40. Marianne, sa jeune femme, met au monde leur fils Jean trois mois après l’abattage, confie l’enfant à ses beaux-parents et disparaît. Eugénie élève Jean dans le culte des héros de la tribu, rabâchant leur histoire parce qu’elle a « si peur que plus personne ne se souvienne quand elle ne sera plus là ». Désiré prend figure de statue du Commandeur, François de modèle et de rival d’un fils fou du sexe, comme lui, et qui se fait écrivain, comme lui, « pas seulement pour tenter de (se) faire aimer, (mais) aussi pour lutter contre la fatalité, l’oubli », comme sa grand-mère.
Le dernier homme de la tribu est le contraire de ceux qui l’ont précédé, dont la légende héroïque a étouffé son enfance de pupille de la nation. Lui n’a jamais voulu combattre, il n’a même pas eu le courage de l’insoumission lors de sa guerre contemporaine, celle d’Algérie. Pourquoi s’attelle-t-il à cette histoire qui le « plombe depuis l’enfance », pourquoi écrit-il ce livre hanté par les morts ? Il ne le sait pas. Il doit l’écrire, c’est tout. Ce roman, espère-t-il, lui « apportera peut-être un peu de paix ». Les sept chapitres de Ce qui disent les morts et les vivants sont la chronique de cette écriture. C’est aussi le bilan d’une vie. Jean a rêvé de célébrité littérature, il n’a fait que la frôler mais n’a jamais renoncé à écrire. Il a navigué très loin, rêvé d’habiter toujours dans la beauté des îles tropicales, gâché ses histoires d’amour au point de ne plus croire à l’amour. Il n’a plus rien, il n’a plus personne, il vit chichement à côté de Toulon dans un petit appartement qui s’ouvre sur la mer Méditerranée, dans une stricte discipline et la plus grande des solitudes. Dans le long monologue qu’il écrit sous nos yeux, Jean parle avec les morts, Désiré et Eugénie qui lui rendent visite et s’assoient sans façon sur la cantine qui tient lieu de divan, sa mère Marianne retrouvée juste avant qu’elle ne meure, il parle dans un bar avec une femme façonnée par le désir et le manque et qui n’existe pas, ou encore à une psychanalyste qui ne répond pas, et même, dans les pages les plus saisissantes peut-être du roman, à un chien. Quant aux personnages réels de sa vie, les copains du marché ou du café du port, ils sont sans importance. Car il ne s’agit pas ici de la réalité, mais de la recherche éperde de la vérité d’une existence. Par le travail de l’écriture.
Jean Marie-Dallet abat son jeu : comme Jean Lecœur le fait des morts il convoque tous ses livres – poussant le culot jusqu’à citer longuement l’un d’eux –, les obsessions qui les hantent, il nomme un par un les écrivains aimés, ses illustres devanciers, ses modèles. Il prend ainsi rang parmi eux, comme Jean Lecœur prend sa place parmi les morts. L’horizon du livre est la disparition du narrateur, quel qu’il soit, dans le silence ; sa perspective est celle de la mort, que l’âge regarde en face, sereinement. Ce roman vertigineux pourrait bien être le livre ultime de l’écrivain, non pas un testament mais l’ouverture à quelque chose d’autre, la paix peut-être qu’espérait le narrateur au début de son travail. L’espoir de l’amour. La vie, tout simplement.
Martine Laval, Le Matricule des Anges
Les écrivains n’ont pas le monopole des états d’âmes. Lorsqu’ils s’épanchent sur leur douleur au travail, entre autofiction et autoflagellation, ils deviennent vite ennuyeux. Jean-Marie Dallet a déniché une parade. Puisque la famille et sa farandole de relations lourdes sinon tordues laisse trop d’empreintes jusqu’à l’asphyxie (ou la page blanche), autant régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Un beau matin, l’écrivain convoque donc le grand-père (et la grand-mère), le père (et la mère), les apostrophe de façon joyeuse, les rudoie même, et… s’attendrit. « Entrez, entrez » leur dit-il, asseyez-vous, racontez-moi tout, et essayez d’imaginer ce que vous m’avez offert en héritage. Je vous le demande : comment être à la hauteur de votre destinée, comment puis-je être moi-même ainsi ligoté tétanisé par vos ombres tutélaires ? Le grand-père : un courage sans borne, vaillant soldat la fleur au fusil dans les tranchées de 14-18, revenu aveugle et malgré l’infirmité instituteur jusqu’à la moelle, jusqu’au bout de sa vie. Le père : auteur d’un premier roman très remarqué, sélectionné par le Goncourt, et qui meurt à la guerre, celle de 39-45 peu de temps avant la naissance du fils et narrateur. Qui se voit lui aussi propulsé dans une autre guerre, celle d’Algérie. Comment échapper à ce monde d’assassins, à ce vingtième siècle? Se borner à devenir solitaire et reclus, boire, s’enticher de femmes, faire l’écrivain ? Est-il envisageable de vivre « petit bonhomme coincé entre un monde peu enviable en train de disparaitre et un monde naissant déjà pire? » Dans Ce que disent les morts et les vivants, bien d’autres guerres jaillissent , traversées de paroles mutilées, de mots effacés, d’idées absurdes, quoique: « S’il ne fallait pas mourir j’aimerais bien ne plus vivre » dit la mère en laissant un immense trou plein de questions.
En convoquant ses démons, sa parentèle, Jean-Marie Dallet abdique et leur fait grâce d’une écriture amoureuse, désespérance et ironie toutes unies. Il se met à l’épreuve, avoue que, jeuneot, il a déclaré des choses ridicules: « les mots c’est ma peau ; écrire pour vivre c’est vivre pour écrire » ou encore se vouloir écrivain c’est se « croire libre ». Une seconde fois, il abdique : que faire d’autre si l’on est bon qu’à ça ? S’y résigner, pardi, et ainsi offrir au lecteur des pages bouillonnantes.
ISBN : 9782916136585
Collection : La Grande Collection
Domaine : Littérature française
Période : XXIe siècle
Pages : 152
Parution : 20 mars 2013