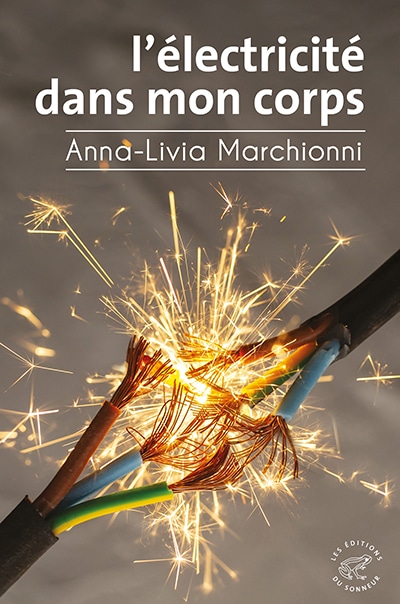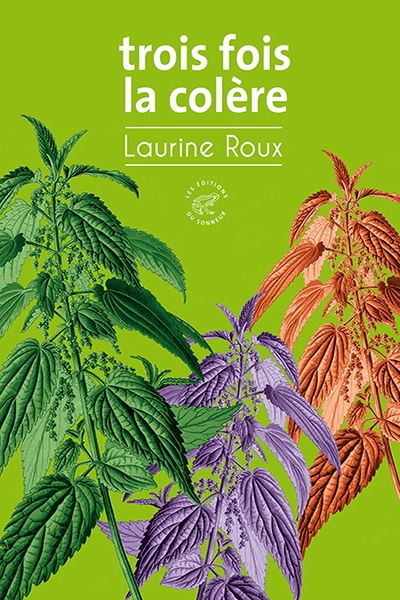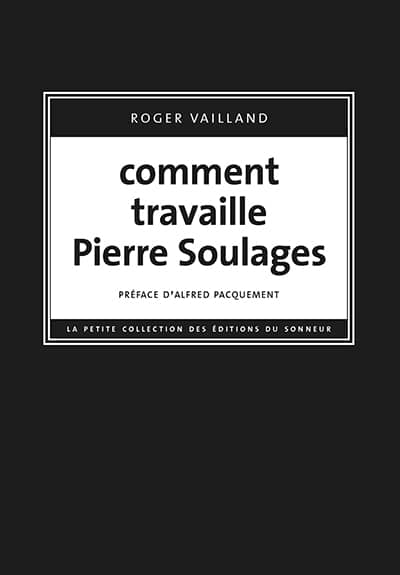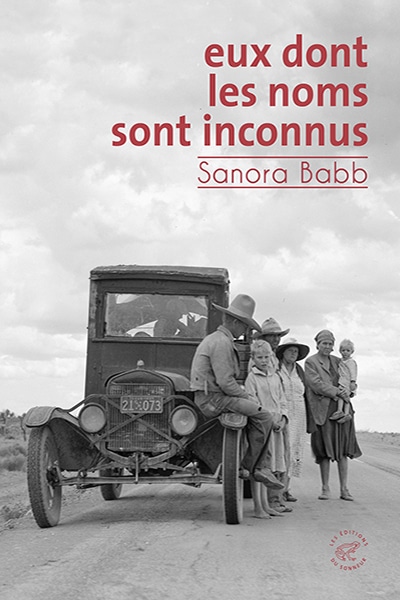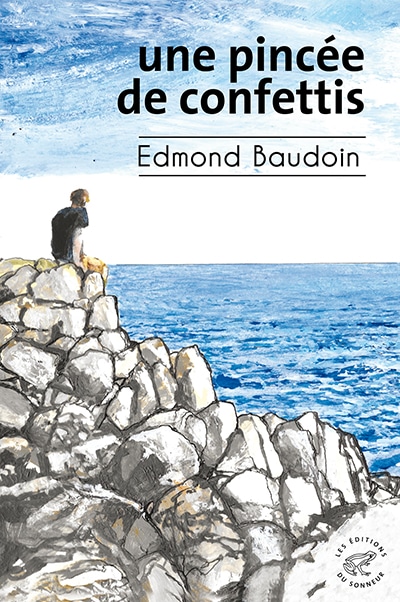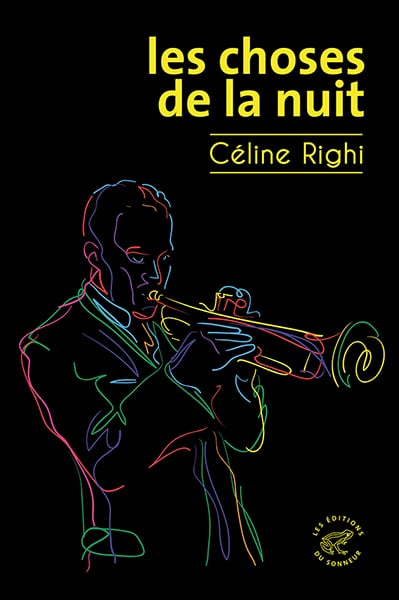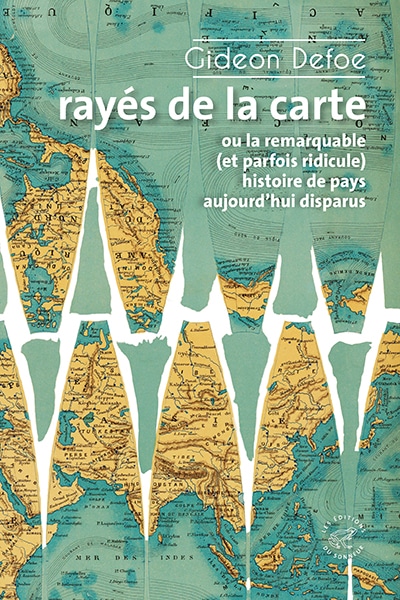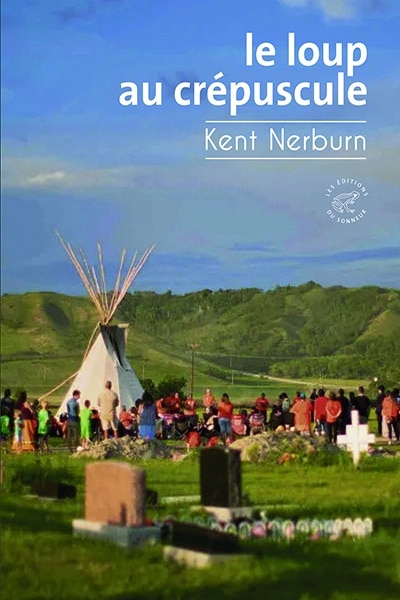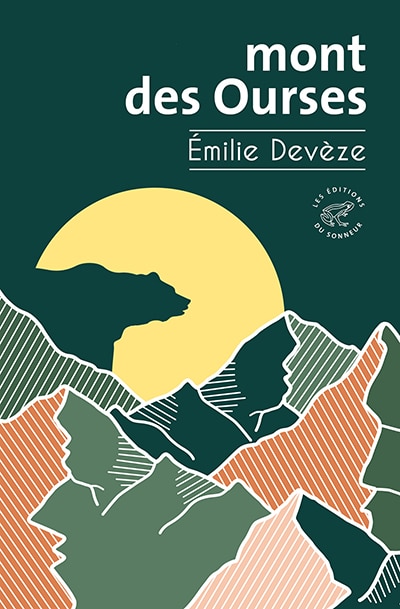Le Monde sur le vif
Martha Gellhorn
Préface de Marc Kravetz • Inédit en français • Traduit de l’anglais (États-Unis) par David Fauquemberg • Ouvrage publié avec le concours du CNL
« Ce livre est un recueil d’articles écrits sur une période de six décennies : mes reportages en temps de paix. Comprenez par là que les pays qui leur servent de décor étaient en paix au moment où je les ai rédigés – même si, plus globalement, on était loin de la paix sur Terre. »
Dans Le Monde sur le vif, l’illustre reporter de guerre que fut Martha Gellhorn (1908-1998) s’éloigne du front : des années 1930 aux années 1980, elle mêle sa vision personnelle de l’histoire aux événements dont elle a été le brillant témoin, toujours aux premières loges. Une scène de lynchage dans le Sud des États-Unis, l’Amérique au temps de la Grande Dépression, l’Angleterre se préparant à la Seconde Guerre mondiale, le procès d’Eichmann, le portrait d’une Vietcong, l’Espagne après la mort de Franco, un plaidoyer contre la torture au Salvador… Les sujets abordés par Martha Gellhorn sont aussi vastes et divers que le furent sa curiosité et sa carrière.
Une traversée du XXe siècle par l’une des plus grandes journalistes américaines.
Née en 1908 aux États-Unis, Martha Gellhorn se destine très tôt à l’écriture. En 1936, elle part pour l’Europe, accréditée par le magazine Collier’s pour couvrir la Guerre d’Espagne — où elle retrouve Ernest Hemingway, son futur époux. Elle devient alors au fil des années l’une des plus éminentes reporters de guerre du vingtième siècle : Seconde Guerre mondiale (elle pénètre dans le camp de Dachau peu de jours après sa libération), guerre du Viet Nam, guerre des Six-Jours, intervention américaine au Panamá… Et si à plus de 80 ans, elle se résigne à ne pas couvrir la guerre en Bosnie, elle se rend tout de même au Brésil pour enquêter sur des meurtres d’enfants des rues. Femme entière, d’une grande exigence morale, elle refuse le déclin de la maladie et décide l’année de ses 90 ans de se donner la mort. Depuis 1999, un prestigieux prix de journalisme porte son nom.
La Croix • Alexis Jenni
Depuis des semaines, ma meilleure amie, c’est Martha Gellhorn. Cela n’a rien de très personnel, puisqu’elle est morte voilà plus de vingt ans et à l’âge de quatre-vingt-dix ans : ce qui n’empêcherait en rien l’amitié mais assure le caractère très platonique de notre relation.
Entre 1930 et 1990, cette femme a fait et vu tout ce que l’on pouvait faire et voir en ce siècle agité, mais surtout elle l’a écrit. Il y a quelques romans qui n’ajoutent rien à la littérature, et des reportages qui sont son grand œuvre, même s’il s’agissait pour elle de gagner sa vie, de se faire payer par les journaux pour aller partout, voir comment c’est, car le journalisme était à ses yeux une forme d’éducation. Ce qu’elle préférait, c’était nager avec un tuba dans la mer des Caraïbes, mais on la retrouve à Auschwitz, à Jérusalem ou à Nowa Huta, à Londres, à Mombasa et à Moscou, c’est vertigineux. Par ses récits, elle m’emporte.
C’est là l’une des vertus des livres, une des raisons pour lesquelles on les aime : ils créent des liens à travers le temps, avec des gens dont on ne connaît que la photographie (et parfois même as, un portrait, un buste, souvent rien). Ce à quoi on se lie, c’est ce ton, le style dit-on, où la qualité du regard, la façon de dire, ceci d’indéfinissable qui touche et qui est la musique de l’écrit, plus fondamentale encore que son contenu explicite. Je lis Martha Gellhorn comme je fréquenterais une amie dont j’apprécie la conversation, l’intelligence, l’humour. Je ne m’en lasse pas.
L’essentiel de ses reportages de temps de paix (elle fut aussi reporter de guerre) ont été traduits aux Éditions du Sonneur (on saluera au passage la forte contribution à la littérature des petites maisons d’édition) : on y trouve J’ai vu la misère. où elle met en fictions ce qu’elle a vu quand elle était envoyée par l’administration Roosevelt pour faire des rapports sur l’état du pays pendant la Grande Dépression, et c’est beau et terrible comme des photos de Dorothea Lange, engagée pour les mêmes raisons : Mes saisons en enfer, où elle raconte ses pires voyages, suite d’aventures rocambolesques qui sont des chefs-d’œuvre d’ironie impolie et d’autodérision: et puis Le Monde sur le vif, cinquante ans de voyages, huit cents pages de merveilles, où l’on voit pêle-mêle un lynchage à l’ancienne dans le Deep South, de jeunes artistes maigres et exaltés dans la Pologne grisâtre de 1959, une tournée des camps palestiniens du temps où Gaza ne comptait que le dixième de la population actuelle, le procès Eichmann, la sale guerre du Salvador, et un retour à Cuba dans les années quatre-vingt, patrie somnolente du communisme déglingué, mais avec le sourire.
J’en passe, bien sûr, c’est le siècle qui défile à hauteur de femme, à hauteur de conversation avec ceux qui vivent au présent ce qui est maintenant décrit à grands traits dans les livres d’histoire. Entendre la mélancolie d’un Tchèque de 1938 au moment où son pays est mutilé par les accords de Munich, ou bien l’inquiétude et le courage d’une famille israélienne en 1956 quand Nasser équipe abondamment l’armée égyptienne, cela permet de saisir humainement ce que L’Histoire fait comprendre intellectuellement, et c’est bien là le rôle de la littérature.
Et puis il y a les lieux, qui font rêver. Non pas qu’ils soient prestigieux, mais ils sont intacts, et vivables. « C’est l’une des bénédictions constantes de ma vie, dit-elle, d’avoir pu découvrir à temps les merveilles du monde. » À temps, dit-elle : puisque depuis tout s’est banalisé, et dégradé. Je n’écris pas ça avec une pointe de nostalgie, c’est l’état objectif du monde, usé par l’activité humaine et la démographie. Elle vit quelques années à Cuernavaca au Mexique, qu’elle qualifie de « charmant village », ce dont personne n’aurait plus l’idée devant la ville bouillonnante que c’est devenu, saturée de gaz d’échappement et de klaxons.
Par ses yeux sensibles, par sa joie de prendre du plaisir à toute découverte, on explore un monde encore divers, où la nature est belle, encore accueillante. La touristisation est bien une catastrophe mondiale. la surpopulation aussi, et l’extension sans fin des activités industrielles. Ce monde qu’elle raconte est dur mais moins désespéré, sans doute est-ce son regard, ce regard amical qu’elle pose sur tout, qui met l’homme au centre de toutes choses.
Sinon, en passant, elle était très belle et fut la femme de Hemingway. Mais cela n’a d’autre intérêt que d’ajouter une note mondaine à cette vie libre et romanesque dont elle fut pleinement l’auteur. Ce qui m’intéresse, c’est de la lire.
Le Matricule des anges • Thierry Cecille
L’œil vivant
De l’Amérique du New Deal au Cuba des années 1980, Martha Gellhorn enquête et témoigne, avec une perspicacité sans faille et une admirable humanité.
Au terme de son existence – et de ces huit cents pages – Martha Gellhorn essaie, modestement, de « formuler une sorte de conclusion » : « Tout au long de ma vie de reporter, j’ai jeté de tout petits galets dans un très grand lac, et je n’ai aucun moyen de savoir si l’un ou l’autre de ces cailloux a causé la moindre vaguelette. Ce n’est d’ailleurs pas à moi de m’en soucier. Ma responsabilité, c’était de fournir cet effort. Écrire est un métier solitaire, mais je ne me sens pas seule. Je fais partie d’une confrérie mondiale d’hommes et de femmes qui s’inquiètent du bien-être de notre planète et de ses habitants les moins protégés. » Nous trouvons bien, dans ces quelques lignes, des mots-clés qui caractérisent le travail comme la personne de ce témoin du siècle : responsabilité, fraternité, attention et souci des plus humbles. Chacun de ces textes, chacune des enquêtes ici rassemblées s’approche en effet au plus près des êtres, dans leur existence fragile et têtue, tentant de rendre compte avec la plus grande justesse – qui alors devient justice – de leurs douleurs ou de leurs espoirs, de leurs luttes, de leur humanité. Ainsi que le remarque Marc Kravetz dans sa riche préface, Martha Gellhorn pratique un « journalisme de terrain » qui sait être à la fois un « un journalisme de parti pris » mais « sans pour autant être un journalisme partisan ».
Née en 1908, elle débarque à Paris en 1930, un peu sur un coup de tête, « grain de sable plein d’une joyeuse confiance, dans la tempête qui se levait ». Elle y écrit ses premiers articles puis retourne aux États-Unis, où elle va mener des enquêtes pour la FERA, organisme chargé de l’aide aux chômeurs au moment du New Deal. En 1936, elle part pour l’Espagne où, dans Madrid assiégée, elle retrouve Hemingway – qu’elle va épouser. Elle devient ensuite une des reporters de guerre les plus célèbres : publié en 1959, La Guerre de face, recueil de ses reportages, rencontre le succès. Mais c’est bien plus tardivement, en 1989, qu’elle constitue cet autre volume que les Éditions du Sonneur nous permettent de découvrir, après avoir déjà publié Mes saisons en enfer et J’ai vu la misère. Le Monde sur le vif se présente comme une anthologie personnelle : Martha Gellhorn y rassemble, pour chaque décennie, des années 30 aux années 80, un choix de textes suivi chaque fois de quelques pages de commentaire autobiographique – « afin que le lecteur puisse découvrir les articles par lui-même, tranquillement, avant de me voir débarquer avec mes explications ».
Nous nous engageons alors dans un voyage à travers l’Histoire et l’espace, avec pour guide une voix inimitable, aux inflexions variées, Martha Gellhorn passant – et parfois dans la même page – de la commisération à l’humour, de l’indignation à la satire, de l’admiration à la colère. Certains sujets sont plus légers que d’autres, certaines scènes plus marquantes – mais jamais notre attention ne faiblit car jamais l’écriture ne fléchit. Les portraits sont vifs et nets, qu’il s’agisse de Joseph McCarthy se ridiculisant par un lapsus révélateur ou d’Adolf Eichmann, « petit homme au cou très fin, avec les épaules hautes, des yeux étrangement reptiliens, des traits anguleux, une chevelure brune dégarnie ». À Rome, en 1949, alors que déjà les touristes reviennent, elle s’intéresse, elle, aux orphelins, bâtards des soldats étrangers : « Les enfants aveugles sont très calmes. Les petits estropiés les guident et leur décrivent ce qu’ils voient. […] Un petit garçon vous dira que sa main lui fait mal alors qu’il n’en a plus ; une petite fille se plaindra de douleurs dans un pied amputé ; l’humidité et la pluie dépriment les aveugles. » Lorsqu’elle se retrouve parmi les mineurs anglais qui luttent contre Margaret Thatcher, elle sait, par la rapide description d’un geste ou d’un vêtement, révéler la détresse ou la volonté de préserver sa dignité. Les dialogues sont également d’une grande efficacité : nous entendons, à ses côtés, les discussions échevelées de ces jeunes Polonais dont le communisme ne parvient pas à éteindre l’ardeur ni l’intelligence – ou les plaintes retenues des mères palestiniennes dans les camps de l’UNRWA.
Certaines phrases, enfin, résonnent aujourd’hui curieusement, fortement – comme si nous les lisions dans le journal du jour ou sur notre page Facebook. Ainsi de la Palestine : « La bande de Gaza n’est pas un enfer, ni un désastre flagrant. La réalité est bien pire : c’est une prison ». Ainsi des chômeurs, où qu’ils soient : « Et les voilà forcés, pour une raison qui les dépasse, à devenir des mendiants demandant la charité, ils se retrouvent obligés de répondre aux questions d’étrangers, et soumis à toutes les misères et les humiliations liées à l’indigence. Leur fierté meurt, mais non sans d’horribles souffrances. »
ISBN : 9782373851892
ISBN ebook : 9782373851984
Collection : La Grande Collection
Domaine : États-unis
Période : XXe siècle
Pages : 800
Parution : 26 septembre 2019